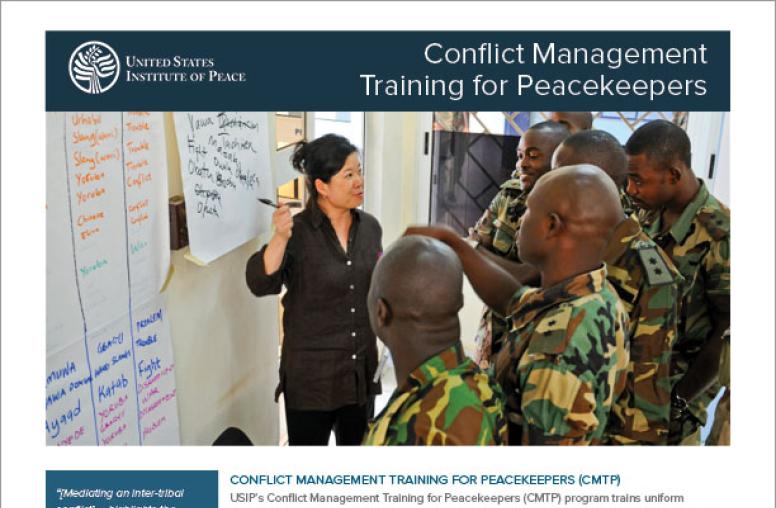Systems Thinking for Peacebuilding and Rule of Law (French)
Penseé Systémique Pour la Consolidation de la Paix et L’état de Droit en Soutien de Réformes Complexes dans des Environnements Touchés par les Conflits
Résumé
- Notre approche traditionnelle de la consolidation de la paix et de l’État de droit semble solide : des objectifs ambitieux, une injection de ressources, des équipes d’experts travaillant intensément. Pourtant nous semblons rarement aboutir à des réformes véritablement fructueuses et durables.
- Pourquoi nous enlisons-nous ? Une des réponses possibles réside dans notre façon de percevoir les systèmes avec lesquels nous travaillons. Nous avons tendance à traiter de nombreux systèmes de consolidation de la paix et de l’État de droit comme s’ils étaient des systèmes d’horloge, c’est-à-dire ordonnés, réguliers et prévisibles. En réalité, les environnements dans lesquels nous travaillons sont plutôt des systèmes de type nuage,en cela qu’ils sont désordonnés, irréguliers et imprévisibles.
- Étayé sur le champ de la pensée systémique, ce rapport invite les spécialistes œuvrant à la consolidation de la paix à utiliser plus d’un angle de vue lorsqu’ils se penchent sur les systèmes et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Parfois, nous devons aborder les problèmes sous un angle technique. D’autres fois, nous devrons adopter un angle plus large orienté sur la complexité du système plus vaste. Et souvent, nous devrons utiliser les deux angles lorsque nous gérons en même temps différents composants d’un effort de réforme.
- Au cours de la dernière décennie, comme beaucoup d’acteurs œuvrant dans le domaine de la consolidation de la paix ont préconisé l’adoption d’approches plus adaptables et flexibles du changement, les auteurs ont cherché de nouvelles façons de faire les choses. Bien que ce rapport offre des idées que les auteurs ont glanées en chemin, leurs conclusions n’essaient pas de prendre en compte ou de gommer toutes les contraintes qui entravent le progrès. Les auteurs ne pensent pas non plus que la pensée systémique soit une formule magique qui résoudra tous les problèmes. Dans son essence, la pensée systémique impose un transfert de pouvoir des acteurs internationaux vers les agents locaux qui ressentent plus intensément le besoin de changement. Si ce changement peut se produire, notre domaine pourra s’attaquer plus efficacement aux forces qui ralentissent ou bloquent la réforme.
- Comment appliquer la pensée systémique dans le monde réel de la consolidation de la paix ? La pensée systémique ne se réduit pas à une formule ou à un guide pratique rigide, car les recueils de règles et les formules sont de peu d’utilité pour appréhender les systèmes complexes. Au lieu de cela, elle nous propose une structure flexible qui nous permet de recadrer les outils habituels de consolidation de la paix et de les utiliser autrement.
- La recherche d’efficacité pousse à considérer ce recadrage comme un ensemble de défis interconnectés. Nous pouvons explorer ces défis en utilisant différentes expériences et observer dans quelle mesure elles sont efficaces. Au lieu de proposer un plan par étapes, ce rapport invite le lecteur à considérer quelles expériences pourraient le mieux convenir à ses propres pratiques de consolidation de la paix. Le rapport comprend une liste détaillée d’expériences ainsi que des conseils pour la résolution de problèmes et un éventail exhaustif de sources en matière de recherche.
- L’utilisation de la pensée systémique n’est pas chose facile. Cela nous oblige à vivre dans un monde truffé de confusion et de retours en arrière. Pourtant, parfois, la pensée systémique peut nous aider à convertir des barrages apparemment immuables en obstacles qui peuvent, avec du temps et de la ténacité, être surmontés. Alors que le conflit violent s’étend à de nouvelles régions du monde, ravageant des villes entières et provoquant le déplacement de millions de personnes, parvenir à améliorer nos chances de réussite peut faire une énorme différence. Stephen Hawking a fait remarquer que le XXIe siècle serait le siècle de la complexité. Si nous voulons changer le monde, nous devons mieux comprendre et intégrer cet élément central de la condition humaine.
- Ce rapport est le premier d’une série de publications et d’engagements qui rapportent ce que les auteurs ont appris sur la pensée systémique. Dans un livre à être publié prochainement, ils donneront davantage de précisions sur ce qui pourrait aider les spécialistes à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les interventions.
À propos du rapport
Ce rapport invite les spécialistes oeuvrant à la consolidation de la paix à intégrer les principes de la pensée systémique et de la théorie de la complexité dans la façon dont ils conçoivent, mettent en oeuvre et évaluent leurs interventions. En se fondant sur les études réalisées au cours des dix dernières années à l’USIP et en s’appuyant sur la littérature d’autres domaines – comme le développement organisationnel, le management situationnel, la gestion du changement et la psychologie – les auteurs prônent des approches plus personnalisées et flexibles dans la consolidation de la paix et de l’État de droit.
À propos des auteurs
Philippe Leroux-Martin est responsable des questions d’État de droit, de justice et de sécurité à l’USIP. Avant de rejoindre l’USIP, Philippe a apporté sa contribution au projet Future of Diplomacy (avenir de la diplomatie) au Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School. Il est l’auteur de Diplomatic Counterinsurgency: Lessons from Bosnia and Herzegovina (Cambridge University Press, 2014). Vivienne O’Connor est une spécialiste de l’État de droit et une universitaire, avec plus de quinze ans d’expérience dans le domaine. Elle travaille actuellement sur des projets de recherche et de formation qui intègrent la pensée systémique et la théorie de la complexité avec le maintien de la paix et l’État de droit. Vivienne est l’auteur de plusieurs livres et articles, notamment Model Codes for Postconflict Criminal Justice, Volumes I et II (USIP Press, 2008).